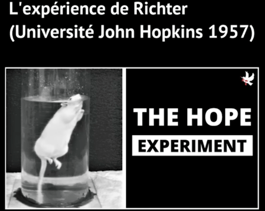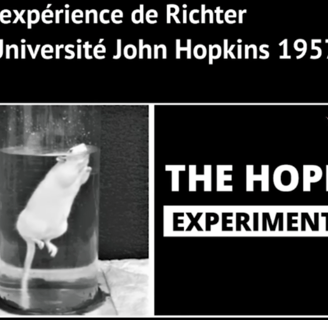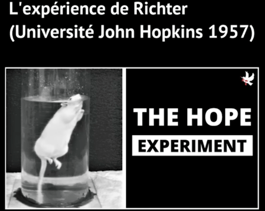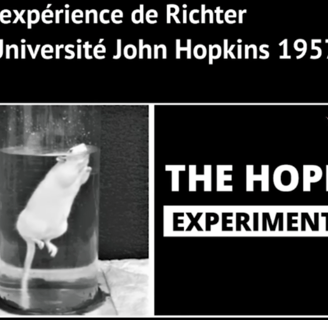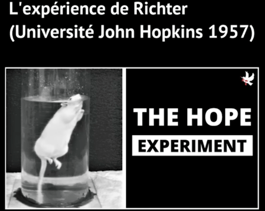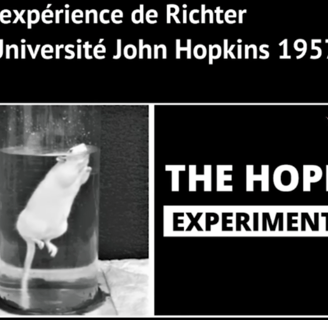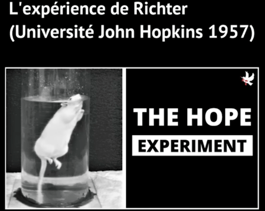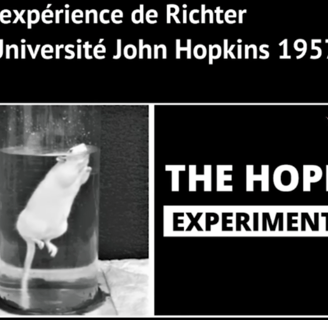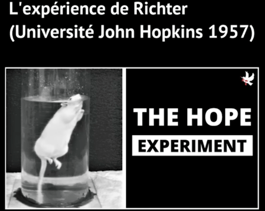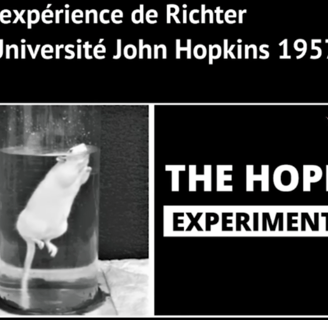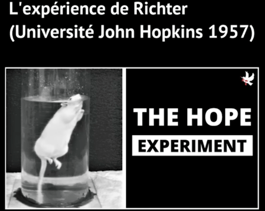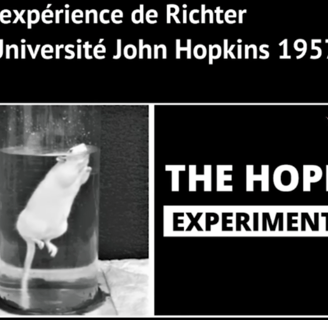Chapitre 12 - L'optimisme
Les concepts en psychologie sur l’optimisme
Idries Shah : “ Je rêve d’un monde où les gens auraient une culture générale en psychologie et connaissent les expériences faites des 70 dernières années. Que ça devienne un mode de pensée naturel et qu'ils se connaissent mieux ”
Source : Conférence : Psychologie de l'Optimisme | Idriss Aberkane
Après une découverte par hasard de ce sujet, je souhaite vous faire découvrir les dernières découvertes psychologiques sur : La façon dont on peut convaincre un humain qu’il est incapable de réaliser quelque chose, ou ce qu'on appelle “l'optimisme appris”. Tout comme l’espoir, ce sont 2 sujets extrêmement important et ont des effets dévastateurs sur l'Homme.
Le but : comprendre notre comportement en faisant des liaisons avec les expériences réalisées ces dernières années. Comme ce blog vise à aider et à éduquer, je dois parcourir ce sujet ! Je pourrais résumer en une phrase :
Être optimiste dans la vie n'est pas naturel et inné pour l'homme, c'est une capacité à apprendre obligatoirement pour l'être ! Et oui !
Expérience de Richter :
Des rats domestiques et sauvages ont été placés dans des réservoirs d’eau pour observer leurs comportements de survie. En moyenne, ils nagent 15 minutes avant d’abandonner et de se noyer.
Richter en a sauvé certains juste avant de se noyer, les séchant et les laissant se reposer avant de les remettre dans l’eau.
Résultat : ceux sauvés une première fois ont nagé en moyenne 1h lors de la seconde immersion. On voit une évolution de 15 min à 1h pour ceux auxquels on leur a montré la possibilité de réussite.
Si on leur montre qu’il y a une possibilité de survivre, cela crée l'espoir et une volonté plus forte de combattre. C'est la même chose pour l'homme, l'espoir est la plus forte des émotions. Un gouvernement souhaitant limiter son peuple doit faire en sorte de restreindre les espoirs avec des annonces négatives en continu pour créer une ambiance triste.
Expérience sur les chiens de Seligman et Maier (1967)
Objectif : Étudier les effets de l'impuissance apprise.
Trois groupes de chiens ont été utilisés.
Groupe 1 : Les chiens étaient attachés et soumis à des chocs électriques, mais ils pouvaient appuyer sur un levier pour les arrêter.
Groupe 2 : Les chiens étaient attachés et soumis à des chocs électriques, mais ils n'avaient aucun moyen de les arrêter.
Groupe 3 : Les chiens n'étaient pas soumis à des chocs.
Par la suite, tous les chiens étaient placés dans une boîte avec deux compartiments et séparés par une barrière. Un compartiment peut recevoir des chocs électriques et l'autre non. Ils pouvaient sauter par-dessus la barrière pour éviter les chocs en allant dans l'autre compartiment.
Résultats
Les chiens du groupe 1 et 3 ont rapidement appris à sauter la barrière pour éviter les chocs.
Les chiens du groupe 2, ayant appris qu'ils ne pouvaient pas éviter les chocs, ne tentaient même pas de sauter la barrière pour se protéger. Ils attendaient que la douleur passe en acceptant leur sort.
Conclusion
L'impuissance apprise peut se développer lorsqu'un individu est exposé à des situations où il n'a aucun contrôle sur les résultats, ce qui peut affecter sa motivation et son comportement futur. Ils avaient appris à se résigner à leur situation.
En 2016, la neuroscience a trouvé que la réaction d’impuissance est normale, biologique (innée) et que l’optimisme s’apprend.
Le cerveau à la préhistoire s'est développé pour éviter de se perdre et de faire des erreurs pour rien, afin de survivre en gardant son énergie.
Donc le cerveau doit choisir rapidement si les efforts en vallée la peine, car elle coute de l’énergie. Il te dit “ne perds pas ton temps, ça ne sert à rien de faire ça, ça demande trop d'énergie. Garde cette énergie pour plus tard”. La personne va alors rester souffrir sans réagir, car ça demande trop d’énergie.
Dans notre société, si une personne fait face à une situation qu’elle juge inévitable ou impossible à changer (message véhiculé par les médias), elle peut développer un sentiment d’impuissance. Cela peut se manifester par une perte de motivation, de la passivité et une tendance à abandonner rapidement face à de nouveaux défis.
Expérience de gratitude de Emmons et McCullough (2003)
Objectif : Étudier les effets de la gratitude sur le bien-être.
Les participants ont été répartis en trois groupes :
Groupe "gratitude" : Les participants devaient écrire cinq choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants chaque semaine.
Groupe "irritation" : Les participants devaient écrire cinq irritations ou choses qui les avaient ennuyés chaque semaine.
Groupe "contrôle" : Les participants devaient écrire cinq événements de leur semaine sans orientation particulière
L'étude a duré dix semaines.
Résultats
Les participants du groupe "gratitude" ont rapporté un bien-être général plus élevé, moins de symptômes physiques et une perspective plus optimiste sur la vie.
Les participants des groupes "irritation" et "contrôle" n'ont pas montré de changements significatifs comparables.
Conclusion
La pratique régulière de la gratitude peut améliorer le bien-être émotionnel et physique.
Expérience Classique de Lepper, Greene, et Nisbett (1973)
Objectif : Étudier comment les récompenses influencent la motivation des enfants.
Participants : Des enfants en maternelle qui aimaient dessiner.
Les enfants ont été répartis en trois groupes :
Groupe 1 (Récompense attendue) : Les enfants savaient qu'ils recevraient une récompense (un bonbon) après avoir dessiné.
Groupe 2 (Récompense inattendue) : Les enfants ont reçu une récompense surprise après avoir dessiné, sans en être informés à l'avance.
Groupe 3 (Pas de récompense) : Les enfants n'ont reçu aucune récompense pour dessiner.
Observation : Les chercheurs ont observé la quantité de temps que les enfants passaient à dessiner lors d'une séance libre deux semaines plus tard après l’expérience.
Résultats
Les enfants du groupe 1 (Récompense attendue) ont passé significativement moins de temps à dessiner lors de la séance libre, comparé aux deux autres groupes.
Les enfants des groupes 2 (Récompense inattendue) et 3 (Pas de récompense) ont continué à dessiner autant qu'avant. Associer une action à une récompense diminue le plaisir de faire cette action. Vous voyiez pourquoi les systèmes scolaires sans notes marchent mieux ?
Trois souris sont mises dans trois boîtes avec une roue pouvant être tourné :
La première ne reçoit aucun choc électrique
La deuxième reçoit des chocs électriques de façon aléatoire
La troisième reçoit des chocs seulement si elle tourne la roue (elle contrôle les chocs)
La deuxième sourit comprend vite qu’elle n’a pas le contrôle sur la roue et les chocs : elle est sous stress permanent.
Résultat : on mesure les ulcères gastriques (plaie profonde qui se forme dans la paroi interne de l'estomac) créé par le stress, chez les trois souris.
Cette expérience prouve que le stress créé par une souffrance qu’on ne contrôle pas à beaucoup plus d’impact sur les organes et la santé du corps qu’un stress classique.
Sur le graphique , le bleu est la taille des ulcères de la souris 3 et en rouge la souris 2 (qui est beaucoup plus grande).
Sur le graphique de gauche, pour la souris 2, ou envoie un signal sonore avant le choc mais sur le graphique de droite, la souris ne sait pas quand elle va recevoir le choc : le fait de ne pas savoir quand arrive un choc aléatoire impacter 3x plus en dégâts !
Facebook a fait une expérience en 2014 pour voir si la négativité est contagieuse.
Ils ont truqué l’algorithme chez 600 000 personnes dans leurs fils d’actualité et ont mis plus de nouvelles négatives.
Résultat : les gens se sont mis à poster à leur tour plus de nouvelles négatives.
Notre cerveau est accro aux mauvaises nouvelles car elles créent des pulsions et plus de ressentis. C’est pour cela que les journaux se vendent mieux avec des mauvaises nouvelles.
Les humains ont une tendance à accorder plus d'attention aux informations négatives qu'aux informations positives. Cela signifie que les expériences et les commentaires négatifs ont un impact plus fort et plus durable sur nous.
Dans certaines situations, exprimer des émotions négatives peut renforcer les liens sociaux, surtout sur internet où nous aimons attirer l’attention. Par exemple, se plaindre ensemble peut créer un sentiment de camaraderie. Cependant, cela peut également mener à un cycle de négativité collective et assombrir sa vie en général.